Requiem pour un massacre d'Elem Klimov est un chef-d'œuvre et il le doit à beaucoup de choses, y compris à son tournage infernal.
Requiem pour un massacre est une expérience, éprouvante, viscérale, inoubliable. Considéré comme l'un des plus grands films de guerre de tous les temps, le long-métrage réalisé par Elem Klimov en 1985 raconte le martyre d'un garçon biélorusse et de son village, attaqué par les nazis, et plonge le spectateur dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale comme aucun autre. Une immersion presque totale, rendue possible grâce à la mise en scène virtuose et oppressante de Klimov, mais aussi un tournage cauchemardesque, qui questionne la représentation de la guerre et des faits historiques dans le septième art.
Ils ont combattu pour la patrie
En 1977, Elem Germanovich Klimov est déjà un grand nom du cinéma soviétique et a tourné deux ans plus tôt ce qu'il considère comme son premier grand film, Raspoutine, l'agonie, qu'il avait attendu de réaliser pendant huit ans en raison de ses scènes d'orgies et de sa représentation nuancée de Nicholas II, jugées offensantes par les autorités (et le film ne sera projeté en Union soviétique qu'en 1981).
Alors que sa compagne, l'actrice et réalisatrice Larissa Shepitko, vient de réaliser L'Ascension, un film de guerre autour de deux partisans biélorusses capturés par les nazis qui empruntent deux chemins bien différents (et qui sera récompensé de l'Ours d'Or à Venise), il réfléchit alors à son prochain projet : un long-métrage inspiré d'un livre qui l'obsède, Je suis d'un village en feu d'Alès Adamovitch, un recueil de témoignages de Biélorusses ayant survécu aux tueries des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec l'auteur, Klimov commence à écrire le scénario de ce film, qui prend une valeur personnelle aussi bien pour lui que pour Adamovitch.
Né en 1933 à Stalingrad, où il a grandi dans une famille communiste, Elem (acronyme d'Engels, Lénine et Marx) Klimov avait été témoin de la destruction de la ville en 1942 lors de la fameuse bataille qui a marqué un tournant de la Seconde Guerre mondiale et été un des épisodes les plus meurtriers de l'Histoire. Dans un entretien donné plus tard, il évoque les souvenirs de sa fuite avec sa mère et son petit frère German, à bord d'une péniche, les visions de la Volga engloutie par les flammes d'un dépôt de pétrole attaqué par les Allemands et leur exode dans l'Oural.
Alès Adamovitch, quant à lui, avait combattu l'occupation nazie avec les partisans biélorusses quand il était encore adolescent, comme Fliora, personnage principal de Requiem pour un massacre et d'un autre récit qui a inspiré son scénario, Kathyn, une nouvelle racontant le massacre du village biélorusse éponyme du point de vue du garçon.
Déçu par Raspoutine, l'agonie malgré des critiques plutôt élogieuses, Klimov est également motivé par les tensions de la Guerre Froide et une éventuelle Troisième Guerre mondiale, qu'il redoute. Adamovitch et lui écrivent une première version, à laquelle ils donnent le titre allégorique de Tuer Hitler (pour "Tuer le Hitler, le monstre en chacun de nous" comme le réalisateur l'expliquera plus tard). Avec le soutien du premier secrétaire du parti communiste biélorusse, Pyotr Masherov, enthousiaste concernant le projet, le réalisateur le propose à Mosfilm, la société nationale de production cinématographique.
Cependant, alors que le tournage s'apprête à commencer à Minsk, le Goskino, le comité d'État en charge du cinéma en Union soviétique, demande à ce que le scénario soit modifié, considérant qu'il fait la propagande de "l'esthétique de la saleté" et du "naturalisme", ce que Klimov refuse. En 1979, Larissa Shepitko meurt dans un accident de voiture alors qu'elle a commencé à tourner son prochain film, Les Adieux à Matiora, une adaptation d'un roman de l'écrivain Valentin Raspoutine.
Affecté par sa disparition, qu'il comble par l'alcool, Klemov réalise un court-métrage biographique en 1980 pour lui rendre hommage, Larissa, puis reprend et termine le film de sa femme en 1981 (il ne sortira qu'en 1983).
En 1984, à l'approche du 40e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique face à l'Allemagne nazie, durant ce qui est appelé la Grande Guerre patriotique en URSS, la production du projet de Klimov est relancée. Un réalisateur biélorusse est envisagé à sa place, mais Alès Adamovitch s'interpose et refuse qu'un autre s'en charge. Klimov obtient finalement l'autorisation de tourner son film comme il le voulait, à la seule condition de changer son titre.
Sur les conseils de son frère German, il choisit alors Idi i smotri (Иди и смотри), qui peut être traduit par "Viens et regarde", formule répétée dans les versets du chapitre 6 des Révélations de Saint-Jean, à l'ouverture de chaque sceau lors de l’Apocalypse. Considérant qu'il est de sa responsabilité de faire son propre film de guerre afin de raconter ce qu'il a lui aussi vécu, il se lance alors dans le tournage de ce long-métrage qu'il voit comme sa "cause sacrée", comme il le déclarera. "Parler de l’immense tragédie qui affecte tout un peuple, d’une guerre qui ressemble à l’enfer lui-même."
Au coeur des ténèbres
Pour donner vie à cet Enfer et le rendre encore plus authentique, au-delà du scénario qui s'appuie majoritairement sur des faits réels, Klimov pousse le réalisme à l'excès. Il tourne son film sur le sol biélorusse, avec des dialogues en biélorusse authentique et en allemand, et dans l'ordre chronologique, durant neuf mois.
Il utilise d'anciens uniformes SS d'époque, de vraies munitions dans la plupart des scènes (y compris pour les obus) et engage des civils et des paysans locaux, dont des survivants des tueries du Front de l'Est, mais aucun acteur professionnel, encore moins pour le rôle principal de Fliora, comme il l'expliquera plus tard dans un entretien :
"J'avais parfaitement compris que le film serait dur. J'ai décidé que le rôle central du garçon du village, Fliora, ne serait pas joué par un acteur professionnel qui se serait immergé dans le rôle et aurait pu se protéger psychologiquement grâce à son expérience d'acteur, sa technique et ses compétences. Je voulais trouver un simple garçon de 14 ans.
Nous devions le préparer aux expériences les plus difficiles, puis les capturer sur la pellicule. Et en même temps, nous devions le protéger du stress pour qu'il ne finisse pas dans un asile de fous après le tournage, mais qu'il soit rendu à sa mère vivant et en bonne santé."
 Lutter pour sa vie, littéralement
Lutter pour sa vie, littéralement
Après plusieurs auditions, durant lesquelles il demande à des enfants de pleurer plusieurs fois avant de leur montrer des vidéos des camps de concentration et de leur offrir un goûter en observant leurs réactions, son choix s'arrête sur Aleksei Kravchenko, qui a refusé de ce qu'on lui proposait après le visionnage (et qui était seulement venu accompagner un ami à l'origine).
Afin de protéger le garçon et l'empêcher de sombrer dans la folie à cause de ce qu'il endure sur le tournage, Elem Klimov fait appel à des psychologues pour essayer de le plonger dans un état d'hypnose, ce qui ne fonctionne jamais. En plus du stress émotionnel, Aleksei Kravchenko est également soumis à un régime drastique, qui l'atteint physiquement comme le montre son visage, de plus en plus marqué à mesure que le tournage progresse et que son personnage se retrouve arraché de son foyer pour être entraîné dans les ténèbres.
Au milieu des forêts et des marécages d'une zone de Biélorussie qu'Elem Klimov ne quitte pas un instant (contrairement au reste de l'équipe), le jeune acteur échappe à la mort à plusieurs reprises. Alors qu'il part à la recherche de sa famille (qui a déjà été tuée derrière la maison sans qu'il le remarque), Fliora et une fille plus âgée, Glasha, traversent un marais, dans lequel Aleksei Kravchenko se noie presque. Et sa détresse transparait clairement à l'écran.
Plus tard, Fliora cherche de la nourriture et trouve une vache, qu'il veut ramener au village, mais les Allemands commencent à mitrailler le terrain. De vraies balles sont utilisées, certaines passent à peine dix centimètres au-dessus de la tête d'Aleksei Kravchenko d'après ce qu'il racontera plus tard, et finissent par réellement tuer la vache, qui s'écroule à côté du jeune acteur et manque de l'écraser.
Cette volonté de restaurer la réalité se retrouve également dans la mise en scène, qui emprunte parfois au documentaire, mais surtout dans la manière qu'a le film de directement interpeller le spectateur avec des gros plans, des plans subjectifs, des regards constants vers l'objectif, de longs plans en Steadycam et un travail impressionnant sur le son, afin de faire ressentir toutes les expériences et les émotions de Fliora et des autres personnages.
Une immersion qui rend l'horreur de la guerre encore plus infecte et qui inspire évidemment de l'empathie pour le garçon, mais qui permet aussi d'appréhender ce qu'ont pu vivre Klimov, Adamovitch et les survivants des tueries du Front de l'Est, aussi bien pendant la Seconde Guerre mondiale et l'opération Barbarossa qu'après.
La séquence finale du film, l'insoutenable massacre des villageois brûlés vifs dans une grange, est tellement réaliste qu'elle a réveillé certains traumatismes chez les interprètes civils comme l'a expliqué le réalisateur : "Pour cette scène, nous avons utilisé des villageois, des non professionnels, principalement des femmes. Comme ils ne répondaient pas à mes instructions de jeu, j’ai réalisé que c’était un mécanisme de défense, que tous les gens filmés avaient dans leurs gênes une mémoire de la véritable terreur."
Conscient qu'il est peut-être allé trop loin, Klimov doute et dit à Alès Adamovitch que le film est trop brutal pour que les gens puissent le regarder, ce à quoi l'auteur et coscénariste lui répond qu'ils doivent quand même le faire, qu'il s'agit de "quelque chose qu'ils doivent laisser derrière eux, comme une preuve de la guerre et un plaidoyer pour la paix."
 Les hurlements avant le silence
Les hurlements avant le silence
IN MEMORIAM
Les conditions dans lesquelles a été tourné Requiem pour un massacre sont certainement condamnables et posent de nombreuses questions éthiques et morales quant à la représentation de la guerre au cinéma, comme a pu le faire Apocalypse Now à une époque (et Requiem pour un massacre est d'ailleurs souvent considéré comme un "Apocalypse Now de la Seconde Guerre mondiale"). D'autres films ont relaté des faits historiques tragiques sans aller dans de telles extrémités.
Toutefois, cette brutalité et ce réalisme impriment durablement la mémoire de ceux qui l'ont vu et font que Requiem pour un massacre se distingue parmi les films de guerre comme l'un des plus éprouvants à regarder justement parce qu'il est peut-être celui qui s'approche le plus de la dérangeante réalité.
En revanche, contrairement à ce que certaines critiques ont pu lui reprocher à l'époque, la violence n'est jamais gratuite et n'est que l'expression de la haine et la cruauté. Le plus difficile à supporter, ce qui met mal à l'aise et suscite autant d'émotion, ce n'est pas la violence, mais ce qui la motive, et le film exprime clairement toute l'absurdité et la folie de la guerre à travers elle dans la scène finale, où les soldats se comportent comme des bêtes sous le regard des officiers qui affichent un calme glaçant alors que les villageois tapent contre la porte pour essayer de se libérer des flammes.
À l'inverse d'autres oeuvres, Requiem pour un massacre n'a pas de vocation dramatique vis-à-vis de l'Histoire, comme on l'a reproché à La Liste de Schindler de Steven Spielberg et à d'autres films. Si Klimov est aussi pointilleux en termes de reconstitution et qu'il dépasse même les limites, ce n'est pas par complaisance ou par spectacle, mais bien par souci de véracité, pour donner la représentation la plus juste et la plus honnête de ce que lui et Adamovitch ont vécu dans leur enfance et des atrocités commises par les nazis en Biélorussie, que Je suis d'un village en feu raconte en partie.
Dans l'interview disponible sur la réédition DVD/Blu-Ray de Requiem pour un massacre chez Potemkine, le réalisateur raconte que le livre contient des témoignages dont la lecture est insupportable et qu'il a considéré l'oeuvre d'Adamovitch comme sa référence absolue pendant le tournage :
"Il se trouvait toujours sur ma table de travail. Le scénario, certes, mais ce livre, je le consultais constamment, parce qu'il m'empêchait de mentir dans mon film, ce serait-ce qu'un tout petit peu. Et c'est un sujet trop sacré pour mentir, pour 'faire du cinéma'..."
Plongé dans le film tel un témoin des événements, le spectateur peut ainsi comprendre et partager l'aspect cathartique, expiatoire de l'oeuvre, mais aussi comprendre la souffrance des personnages, brute, authentique, qui provient non pas du long-métrage et de ce qui peut montrer, mais bien des événements dont il est tiré et qu'il "reproduit".
Et même s'il a voulu être le plus juste possible dans sa représentation de la guerre, Klimov a lui-même reconnu que tout ce qui est montré dans le film n'est qu'une version "allégée" de la réalité : "Si j'avais inclus tout ce que j'ai connu et que j'avais montré toute la vérité, même moi, je n'aurais pas pu le regarder."
 L'innocence remplacée par la souffrance
L'innocence remplacée par la souffrance
Lorsque le Lacrimosa du Requiem de Mozart (qui donne son titre français au film) résonne dans les dernières minutes, comme une prière adressée aux villageois et à tous les morts de la Seconde Guerre mondiale, et que la caméra reste figée sur le visage de Fliora, qui ressemble à vieillard après tout ce qu'il a vécu, un simple panneau annonce à l'écran que "628 bourgades de Biélorussie ont été détruites par le feu avec tous leurs habitants".
Un fait qui permet alors de prendre conscience du mal et de l'horreur historiques, bien réels, tandis que Fiora rejoint les autres partisans en train de marcher au milieu de la forêt vers une prochaine bataille, une prochaine tuerie.
À la toute fin d'un entretien disponible sur YouTube, Elem Klimov marque une pause puis lance un bref regard à la caméra, revient à celui qui l'interroge et déclare : "Je ne regrette pas d'avoir fait ce film. Il a eu un développement et une histoire difficiles. Mais il faut parfois faire la différence, pour faire quelque chose de louable. C'est là que réside la création, lorsqu'on peut offrir aux gens quelque chose de sérieux, qui a une valeur, un sens."
La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter















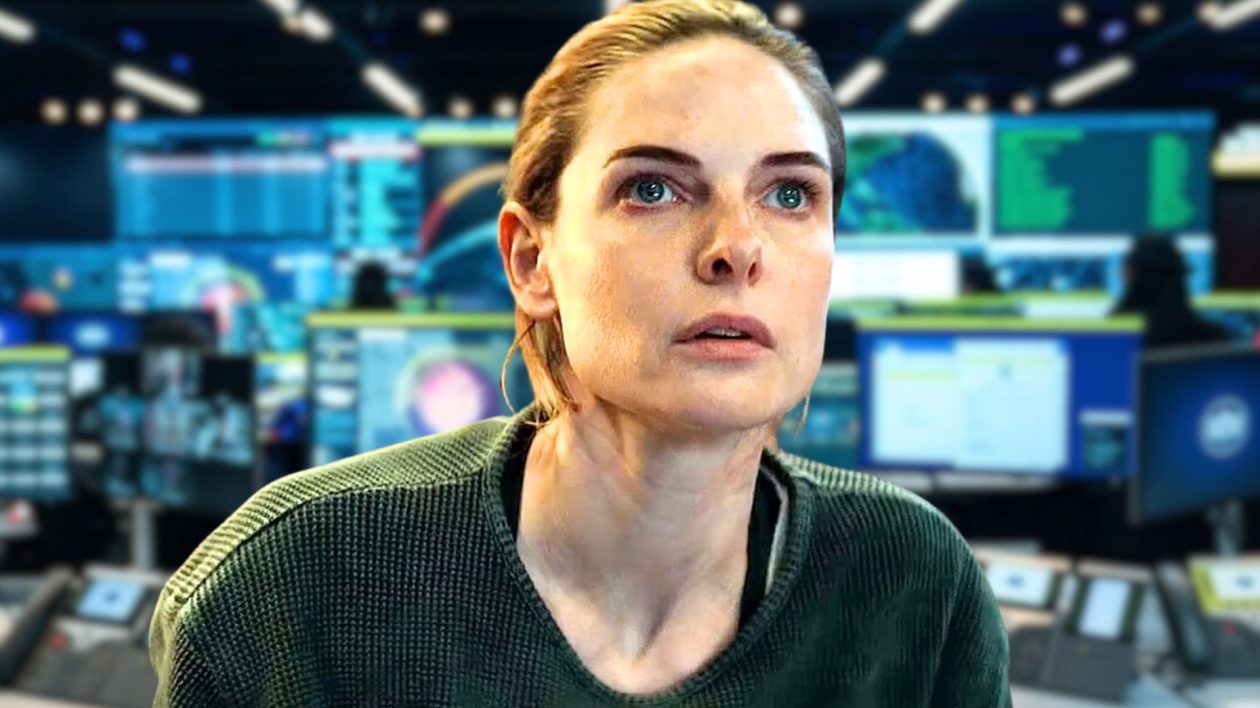
Je n’ai jamais vu ce film (et là, je rejoins Kyle Reese à propos du bon « mood » pour le (re)découvrir) et pourtant en lisant cet article, j’ai tout de suite repensé à d’autres œuvres vues durant mon enfance (et qui m’ont fortement marqué) : Le vieux fusil (portant sur le massacre de villageois français par les nazis en déroute) ou encore la série Holocauste, même si ces œuvres n’ont pas été créées/tournées dans les mêmes conditions que Requiem pour un massacre.
Dommage pour la séquence snuff, d’après ce que j’ai lu.
Revu au club de l’étoile lors de la ressortie de la nouvelle copie. A la fin du générique, grand silence dans la salle, pas un mot, le public est resté assis de longues minutes comme assommé par ce qu’il venait de voir. Certains dans la salle devaient le voir pour la première fois et ça a dû leur faire tout drôle.
Enorme souvenir, je l’avais découvert en vhs à l’époque. Des images qui vous hante longtemps après la projection. Je me souviens de la scène de bombardements en pleine forêt totalement hallucinante, de cet avion qu’on entend plus qu’on ne voit mais qui annonce de terribles choses à venir… Jamais un regard sur la guerre n’a été traité de cette façon. Une expérience viscérale extrêmement derangeante mais nécessaire. Avoir absolument !
Le film le plus éprouvant qui m ait été donné de regarder, toujours d Images en tête !
Enfin on parle du Grand Cinéma.
Ce film est une perle noire! La photographie, les cadres, les acteurs….
On se demande vraiment si on ne regarde pas un documentaire/reportage la 1ère fois que l’on tombe dessus.
Le mot qui me revient le plus en tete à la simple mention de ce film: Viscéral.
Rarement un film a atteint un tel degré de réalisme sur une des périodes les plus affreuses de notre récente histoire.
Là, on parle de Chef D’Oeuvre oui.
Terriblement beau et horriblement orchestré avec maestria.
Merci à Ecran Large de parler d’un des plus beaux,tristes,désespérés et désenchantés tableaux que le cinéma a offert
@Kyle Reese.Tu es loin d’en faire des tonnes.C’est une experience cinematographique extremement eprouvante. J’ai fais l’exploit de visionner ce chef d’oeuvre 2 fois dans ma vie. Et crois moi que la deuxieme fois a été plus eprouvante que la 1ere.A vrai dire,je ne crois pas que je regarderai une troisième fois ce film.
Même situation et ressenti que @Kyle…& je ne pense pas que tu en fasses des tonnes;)
Je l’ai acheté « les yeux fermés » en DVD, il y a de nombreuses années. Quel choc ! Tantôt onirique, tantôt prosaïque dans sa forme mais toujours cauchemardesque dans son fond. Les images cruelles, à la limite du soutenable, bouleversantes, laissent peu de place à l’espoir illusoire de cette fuite en avant pour la survie. Comme un chant d’horreur et de mort désespéré et implacable. Jusqu’au final aussi surprenant que sidérant sur les origines du mal absolu incarné.
Superbe !