Deux ans avant Drive et sa renommée subséquente, Nicolas Winding Refn signait une fable sacrificielle plus poétique encore avec Valhalla Rising.
Propulsé sous les feux du grand public par les néons de l'atmosphérique Drive, Nicolas Winding Refn s'est rapidement illustré comme un cinéaste concevant moins son art selon un prisme narratif qu'esthétique, voire sensible. Disons plus simplement que son cinéma se ressent et s'éprouve plus qu'il ne s'intellegibilise.
Si aujourd'hui, le Danois est principalement reconnu pour ses thrillers compendieux tels que The Neon Demon ou encore Only God Forgives, son Valhalla Rising (ou Le Guerrier Silencieux en France) revendiquait déjà les codes d'un cinéma à l'épure déroutante. Présenté en avant-première au festival de Venise en 2009, le projet se résume grossièrement aux pérégrinations d'un Mads Mikkelsen mutique dans le giron glacé des alpages écossais, et nombreux furent ceux à y lire simultanément critique acerbe et plaidoyer religieux. Certes. Mais encore ?
{videoId=1493829;width=560;height=315;autoplay=0}
fiat lux et autres fables
Le lien à la religion, à ses intrications et à l'éventuelle dénonciation de ses dérives s'impose initialement comme la grille de lecture la plus évidente. Avant même d'étendre l'analyse aux personnages, le paysage choisi par le cinéaste confère au long-métrage une sainteté manifeste. Outre son silence cérémonial, lequel induit un état quasi méditatif au spectateur, les étendues de végétation luxuriante, les montagnes impassibles au sang versé à même la roche et l'usage parcimonieux d'une bande sonore extradiégétique déplacent cet espace-temps à la lisière de l'Au-Delà.
Le carton introduisant le récit ne laisse guère place à l'imagination : "Au commencement, seuls existaient l'Homme et la Nature. Puis, des porteurs de croix vinrent et chassèrent les païens jusqu'aux confins de la Terre." Inutile d'écumer ses vieux cours de catéchisme pour observer l'évident parallèle avec les premiers mots de la Genèse – "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre", et peu ou prou tout ce qu'il s'en suit.
Le spectateur ne tarde donc pas à apprendre que One-Eye, auquel Mikkelsen prête ses traits, fut réduit en esclavage par un clan viking, et condamné à livrer bataille en guise de divertissement, convoité par d'autres pour sa violence. Un autre chef avertit son homologue : nul n'a jamais été en mesure de le garder captif plus de cinq années durant. Le premier refusant de le lui céder, ce qui devait arriver arrive ; un bain de sang plus tard, le borgne s'émancipe de sa condition, et emmène le jeune Are, seul individu à lui avoir jamais témoigné le minimum d'égard.
Rapidement, il croise le chemin de chrétiens dont les scrupules n'ont d'égal que ceux de ses anciens geôliers. En effet, ces derniers ne rechignent nullement à verser dans la colonisation, le meurtre, le viol, et autres joyeusetés. Mais après tout, "ils dévorent leur propre Dieu ; mangent sa chair ; boivent son sang". La barbarie ne semble-t-elle pas de mise pour de pareils individus ? Ces différentes figurations à l'esprit, difficile d'arguer en faveur de quelque foi que ce soit dans l'univers de Nicolas Winding Refn. Quid cependant de One-Eye ?
En dépit de sa condition, le personnage – si tant est qu'il en soit réellement un – apparaît singulièrement serein. Rien ne semble prompt à l'émouvoir, ni même à lui arracher une réaction qui ne soit pas relative à un instinct primal. Loin d'être un animal sauvage bon à réduire l'ennemi en pâture, One-Eye se positionne davantage comme une entité supérieure, voire mystique, et les parallèles avec Odin et Jesus Christ sont légion.
Borgne lui aussi, le dieu nordique aurait sacrifié son oeil dans la quête de Mimisbrunn, source de la sagesse ; il est également en mesure de lire l'avenir, une faculté que partage le personnage de Mikkelsen. Pour ce qui est du Messie chrétien, nul besoin de se rendre à la messe du dimanche pour savoir que le bougre a choisi de mourir sur la croix en vue de repentir l'humanité de ses moult péchés. Certes, One-Eye n'absout pas l'Homme du Mal, mais son sacrifice final sauve la vie de l'enfant qui l'accompagne – allégorie d'une innocence et d'une bonté à préserver. Entre autres.
Au nom du père, du fils (et du Saint-Esprit)
Il n'est pas bien nécessaire d'être fervent chrétien pour avoir déjà entendu la prière "Notre père qui est aux cieux". En dépit des sempiternelles guerres de religion ayant pris place à travers l'Histoire, les différents modes de croyances ont généralement bien des principes communs ; la figure du divin comme guide ou figure paternelle est un exemple parmi tant d'autres, mais il est le plus probant à l'étude de Valhalla Rising.
Aussi, il n'y a probablement rien de fortuit à ce que Nicolas Winding Refn ait choisit de dédier le film à son neveu, Oliver Winding. De toute évidence, il n'en est pas le géniteur, mais le cinéaste n'en serait-il pas, quelque part, un père spirituel apte à lui montrer les voies à emprunter lors de son expérience terrestre ? Cette simple dédicace, apanage régulier des oeuvres du Danois, peut ainsi s'entendre comme l'angle par lequel appréhender le film.
Décrit par le principal intéressé comme un "trip sous acide", Valhalla Rising s'apparente davantage à une réflexion relative aux retors de la paternité. Non, One-Eye ne se mue pas en papa-poule à la seconde où il décide de prendre l'enfant sous son aile – si tant est que l'on puisse réellement qualifier cette nouvelle dynamique de la sorte. Et pourtant, à mesure que les différents chapitres du film se succèdent (La Colère, Le Guerrier Silencieux, Les hommes de Dieu, La Terre Sainte, L'enfer, et enfin, Le Sacrifice), la relation entre One-Eye et Are semble progressivement renvoyer à l'idée de filiation.
Motivé par un sentiment confus de reconnaissance et plus tard, d'une affection endiguée par une vie passée loin des considérations sentimentales, One-Eye assure la protection de l'enfant tout au long de leur voyage. Et ne dit-on pas que devenir père change un homme comme rien d'autre ? Plus encore, le lien intrinsèque qui les unit sous-tend la qualité suprasensible caractéristique aux relations entre un parent et son enfant. En effet, Are est le seul à être en mesure de communiquer avec One-Eye, tant et si bien qu'il se fait régulièrement traducteur, ou intermédiaire entre le personnage et les autres.
Une séquence en particulier se veut éloquente à ce sujet ; alors que l'enfant s'effondre de fatigue, One-Eye entreprend de le porter sur son dos. À première vue, cette scène témoigne au pire de la réticence du personnage à ralentir la cadence, au mieux d'un désir de porter secours au jeune garçon. Mais le montage suit la scène d'un dialogue pour le moins équivoque.
Pourrais-je pardonner à mon père de m'avoir envoyé ici ?", s'interroge un personnage en arrière-plan. "Je suis venu ici pour obtenir le pardon de mon fils", lui répond un autre, plus âgé. Échange auquel se superpose le visage capturé en contreplongée de Mikkelsen, les traits éclipsés par un halo solaire. Il y a plus subtil comme image. Il y a moins poétique, aussi.
 De l'art d'extérioriser ses daddy issues
De l'art d'extérioriser ses daddy issues
Psaumes 17:8
Cette idée de figure paternelle renvoie bien entendu à une autre, plus ambivalente et plus complexe. Si l'Homme peut être père, un père est-il un homme ? La masculinité dont Valhalla Rising semble faire le portrait est primaire, réduite à des instincts si basiques qu'ils se rapportent davantage à l'animal qu'à l'humain. Vikings ou chrétiens, tous sont violents, et n'existent que pour asseoir leur domination sur l'Autre. Pour sa part, One-Eye a beau s'illustrer lors de de multiples séquences de lutte sanguinaire, il n'a rien de foncièrement cruel, ou d'insensible.
La performance de Mads Mikkelsen, toute en retenue affirmée, ne pourrait-elle être comparée à l'idéal masculin qu'impose de nombreuses normes systémiques ? Celui d'un individu laconique au coeur gardé et à la force brute. Autant de qualités justement projetées à travers le film dans sa globalité, tant par son rythme lancinant, son silence, sa violence graphique, sa colorimétrie terne, que par son décorum impitoyable. Le "père" de Nicolas Winding Refn est à l'image du divin : tout puissant, mais faillible.
Incapable d'étendre son amour de quelque façon que ce soit, la figure paternelle se contente d'endosser le rôle de pilier défensif envers et contre tout. De fait, quoi de mieux pour entériner religion et filiation que la notion de sacrifice ? C'est ainsi que malgré ses indéniables capacités physiques, One-Eye choisira la mort afin de laisser la vie sauve à son héritier.
Si la mythologie nordique tient l'abandon en disgrâce – l'unique moyen d'accéder au Valhalla requérant de périr au combat –, le don de sa propre vie au profit d'une autre est l'un des concepts les plus absolus de la chrétienté. L'ultime acte de One-Eye n'en est pas un ; sa capitulation est totale.
Bien plus qu'une métaphore religieuse, Valhalla Rising se propose donc d'explorer une dynamique plus ancienne encore que le concept même de la foi. Du père au fils, du fils au père, la relation est multidimensionnelle, mais son lien est inné. Sans se soucier de dialogues ou, plus surprenant encore, d'effets ampoulés, Nicolas Winding Refn livre à travers ce film une oeuvre plus intime que son synopsis ne pourrait le laisser deviner ; celle d'une fable intemporelle.
David J. Schow John Shirley, les scénaristes du The Crow d'Alex Proyas n'avaient probablement pas tort de glisser dans la bouche d'Eric Draven les mots "Maman est le premier nom de Dieu dans la bouche de tous les enfants". Ajoutons simplement que chez d'autres, "papa" l'est aussi.
La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter











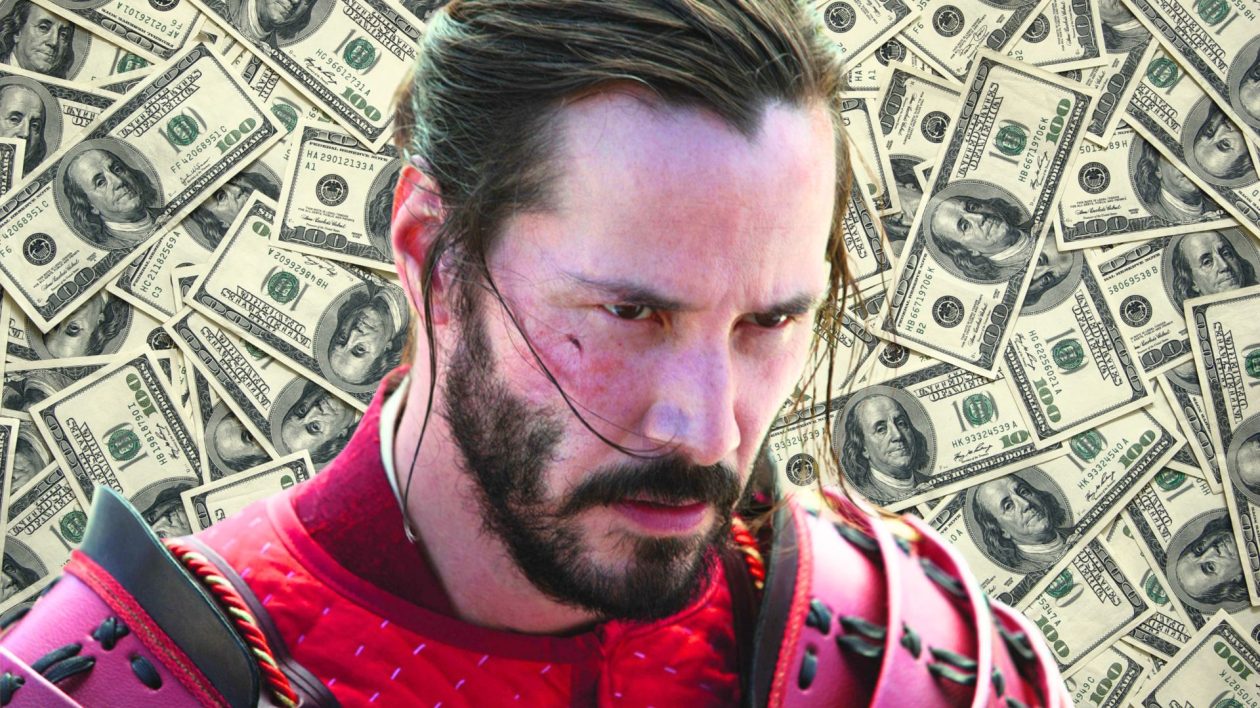
Le seul NWR que je n’aime pas. Me suis royalement emmerdé.
Film incroyable de maîtrise technique et narrative.
NWR va jusqu’au bout de son délire et livre un film hermétique et sans concession.
J’adore !
Perso, je me suis un peu ennuyé devant ce film, même si je salue la performance de mikkelsen, et jai apprécié la beauté des décors naturels.
Ma première rencontre cinématographique avec NWR. Un choc au cinéma, l’impression d’avoir vu un véritable trip halluciné. Film âpre, violent et mystérieux, première rencontre Mads Mikkelsen aussi. On ressent la dureté de l’environnement et de l’époque. Étonnamment Drive est ensuite passé sous mes radars à l’époque, je l’ai vu quelques mois avant de découvrir Only God Forgives, et NWR est devenu et resté un de mes réals préférés depuis, du fait de son esthétisme léché, son coté poseurs aussi qui lui est propre et parce que j’aime les néons. Bref excellent film, je regrette put être juste le fait qu’il me semble qu’il ai été filmé en numérique et ça se voit avec un gros manque de nuance de ton, de définition et les hauts lumières cramés et c’est bien dommage.