20 ans après sa sortie, The Room trône toujours au panthéon des nanars. Mais comment le « Citizen Kane des mauvais films » est-il devenu aussi culte ?
“You’re tearing me apart Lisa !”, “Oh hi, Mark” et autres “You’re just a little chicken, cheep cheep cheep” sont autant de répliques bien connues des amateurs et amatrices de nanars, qui ont forcément vu, au moins une fois, The Room, le film incroyablement mauvais de Tommy Wiseau.
Encore projeté partout dans le monde, lors de séances festives et ritualisées, The Room trône au panthéon des nanars, vingt ans après sa sortie. Tommy Wiseau s’offre régulièrement des bains de foule, acclamé par un public chauffé à blanc par la véritable expérience collective qu’offre une séance de The Room. Comment ce film, souvent qualifié de « Citizen Kane des mauvais films », est-il devenu aussi culte ? Et comment l’un des pires films jamais réalisés a offert à son réalisateur l’une des plus improbables success-stories d’Hollywood ?
Désastreux artiste
Pour expliquer le culte autour de The Room, il faut revenir à la genèse du film et à la rencontre, dans un cours de théâtre à la fin des années 90, de Tommy Wiseau et Greg Sestero. Ce dernier raconte tout – ou presque – dans son roman The Disaster Artist, coécrit avec le journaliste Tom Bissell et publié en 2013. Le contenu du livre est par ailleurs certifié 99,9% vrai par Tommy Wiseau, qui entend garder les 0,1% restants secrets…
Enchaînant les castings, sans succès, les deux aspirants acteurs deviennent amis, et même colocataires à Los Angeles. Face à la difficulté de percer à Hollywood et refusant d’être cantonné aux rôles de méchants pour lesquels on lui propose d’auditionner, Tommy a une idée. Puisque personne ne veut lui donner sa chance, Tommy va écrire un rôle à la mesure de son talent, puis réaliser et produire son propre film. Après tout, on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Seulement, le résultat est loin de l’ambition du projet.
 Le triangle amoureux le plus dramatique de l’histoire du cinéma
Le triangle amoureux le plus dramatique de l’histoire du cinéma
Bien qu’il revendique des influences telles que Tennessee Williams, Alfred Hitchcock, Orson Welles, Marlon Brando ou encore James Dean, le scénario de Wiseau est aussi mauvais que sa façon de jouer. Si le pitch est simple, le scénario semble écrit par une personne n’ayant jamais vu un seul film de sa vie. Véritable drame, un rien misogyne et plein de clichés, The Room raconte l’histoire de Johnny (Wiseau), un banquier que sa petite-amie Lisa trompe avec son meilleur ami Mark (Sestero).
Les dialogues semblent quant à eux écrits par un enfant de six ans, tout comme la plupart des interactions des personnages, qui se font des passes avec un ballon de football américain sans aucune raison. À peine lancées, les sous-intrigues sont abandonnées, et on ne saura jamais véritablement à quoi le titre fait référence. La palme du malaise est sans nul doute décernée aux scènes de sexe, sur un lit à baldaquin parsemé de pétales de roses, avec de longs plans au ralenti sur les fesses de Wiseau, s’imprimant dans la rétine du spectateur, à jamais.
 On vous épargne les photos de fesses
On vous épargne les photos de fesses
Malgré un budget pharaonique de six millions de dollars (dont on ignore encore à ce jour l’origine), le tournage est catastrophique, et guidé par une multitude de mauvaises idées. À commencer par le choix aussi incompréhensible que coûteux d’acheter tout le matériel, au lieu de le louer, et de tourner le film à la fois en numérique et en digital. Il décide aussi de tourner les scènes du toit sur fond vert, et de recréer numériquement les vues de San Francisco, au lieu de tourner sur son propre toit. Sur le plateau, Wiseau est insupportable et met les nerfs de son équipe et de ses acteurs à rude épreuve, d’autant plus que le tournage s’éternise et dure six interminables mois…
Et pourtant, le résultat est fascinant. S’il est à mille lieues du chef-d'œuvre que visait Wiseau, il tombe pile dans la définition du nanar : un film tellement mauvais qu’il en devient involontairement drôle. Car TOUT est raté dans The Room. Tous les mauvais choix de Wiseau, faisant fi de décennies d’histoire et de techniques du cinéma, se révèlent être un alignement des planètes inespéré. Tout est raté, mais juste assez pour maintenir ce fragile équilibre qui transforme un simple navet en merveilleux nanar.
 Pourquoi tourner sur un vrai toit quand on peut tourner sur fond vert ?
Pourquoi tourner sur un vrai toit quand on peut tourner sur fond vert ?
Lors de sa sortie en salle (oui, au singulier, car Wiseau avait simplement besoin d’une sortie technique dans une seule salle pour pouvoir soumettre son oeuvre aux Oscars), deux étudiants en cinéma, Michael Rousselet et Scott Gairdner, tombent sur le film. Ces “patients zéro” de The Room invitent alors leurs potes à voir le film, et c’est là que le culte commence. Malgré un panneau d’affichage géant avec le visage fantomatique de Tommy et son numéro de téléphone fixe (il paye 300 000 dollars pour faire la promotion du film pendant plusieurs années), c’est surtout le bouche-à-oreille qui fait son œuvre au fil du temps.
On parle de plus en plus du film et les cercles de fans s’agrandissent. À la manière d’un Rocky Horror Picture Show, The Room est projeté en festivals et en séances de minuit, avec un dress code et une série de rituels très précis qui se mettent en place. Car si voir The Room seul chez soi est une véritable épreuve, les fans se réunissent pour des séances festives, et scandent les répliques du film, saluent les personnages à chaque entrée, jettent des cuillères en l’air et hurlent « SAN FRANCISCO » à chaque plan de la ville.
 Les lunettes de soleil, le chien, le cadrage, les répliques...
Les lunettes de soleil, le chien, le cadrage, les répliques...
Mystérieux Wiseau
En bon businessman, Tommy Wiseau a profité du culte de son film pour bâtir et consolider son mythe personnel. Le réalisateur a visiblement décidé d’embrasser l’improbable carrière de son film et a accepté son sort. Il a atteint son but ultime : il est devenu un réalisateur célèbre et acclamé. Peu importe la manière, le résultat est là.
Avec un brin de mauvaise foi, il déclare aujourd’hui à qui veut l’entendre que tout était volontaire et calculé, que The Room était destiné à être une comédie. Une énième réécriture de l’histoire qui fait partie intégrante de son personnage, de ses nombreuses contradictions et des zones d’ombre qui entourent sa vie.
 et même une comédie romantique
et même une comédie romantique
Car on sait très peu de choses sur le passé de Tommy Wiseau, qui s’emploie à brouiller sans cesse les pistes et entretient le mystère quant à son identité, son âge et surtout, l’origine de sa fortune. Le livre de Greg Sestero donne bien quelques éléments de réponse, notamment sur son nom, qu’il aurait changé en s’inspirant du mot français “oiseau”. Originaire d’Europe de l’est, Tommy Wiseau aurait fait un passage en France, à Strasbourg notamment, où il aurait travaillé comme plongeur dans un restaurant, avant de s’embarquer pour les États-Unis. À San Francisco, il aurait vendu des jouets dans la rue à des touristes, puis monté une combine d’import-export de jeans et de vestes en cuir. Tout ceci reste flou et n’explique certainement pas la provenance des six millions de dollars qui lui ont servi à tourner The Room.
En interview ou sur scène, Tommy Wiseau esquive les questions sur sa vie privée et détourne la conversation, pour la replacer sur les rails du mythe personnel qu’il s’est créé. Le mythe d’un businessman qui a réussi, un self-made-man à l’américaine, originaire de Louisiane, que son accent d’Europe de l’Est vient gentiment démentir.
Celles et ceux qui ont collaboré avec lui, de près ou de loin, connaissent ses caprices de diva et ont fait face à ses demandes abracadabrantesques (il lui faut par exemple toujours un verre d’eau chaude à portée de main, qu’il ne boit jamais…). Mais pourtant, en off, loin des caméras et des appareils photo, Tommy baisse sa garde et sort parfois du personnage qu’il s’est créé. Il lui arrive de dévoiler un aspect de sa personnalité étonnant, une certaine naïveté et un côté enfantin presque attachant, avant de retourner à son mystère, derrière ses indéboulonnables lunettes de soleil.
Ce mystère ne l’empêche pas de capitaliser sur le film, bien au contraire, et de devenir le businessman qu’il a toujours rêvé d’être. Il affirme, sans que l’on puisse vérifier s’il dit vrai, qu’il a remboursé sa mise de six millions de dollars avec le succès du film. Sur son site, il décline une multitude produits dérivés : affiches, Blu-ray du film, photos dédicacées, scénario de The Room signé de sa main, tee-shirts, mais aussi des sous-vêtements Tommy Wiseau !
Reconnaissance hollywoodienne
C’est en 2017 que Tommy Wiseau accède à la véritable consécration et aux honneurs d’Hollywood, avec l’adaptation au cinéma de The Disaster Artist par James Franco. L’acteur, révélé par l'excellente série Freaks and Geeks, a décidé d’incarner Tommy Wiseau à l'écran. Il faut reconnaitre que la ressemblance est frappante tant Franco pousse loin le mimétisme. Perruque brune hirsute, lunettes de soleil, accent à couper au couteau : James Franco rejoue les scènes de The Room avec son frère Dave Franco, dans le rôle de Greg Sestero.
Le casting est complété par Alison Brie, la femme de Dave Franco, et Seth Rogen, un des meilleurs amis de James Franco. D’autres acteurs hollywoodiens viennent se disputer petits rôles et caméos : Bob Odenkirk, Judd Apatow, Josh Hutcherson, Zac Efron, Kristen Bell, Kevin Smith, Adam Scott, Bryan Cranston, J.J. Abrams, Danny McBride… Sans oublier Tommy Wiseau, et Greg Sestero (malheureusement coupé au montage).
Entre comédie et biopic, le film dresse un portrait plutôt positif de Tommy Wiseau et oublie totalement l’aspect sombre et tordu de sa relation avec Greg Sestero, que l’acteur racontait pourtant dans son livre. The Disaster Artist version Franco est donc une comédie qui tourne presque par certains aspects à la private joke et ressemble à un film de potes qui rejouent des scènes de The Room.
En effet, James Franco l’avoue sans détour : il est fan de The Room et a voulu adapter le livre de Greg Sestero pour cette raison. Il est difficile de ne pas voir dans son film un côté méta, et un entre-soi hollywoodien que Tommy Wiseau dénonçait justement. Mais encore une fois, qu’importe, Tommy Wiseau a eu ce qu’il voulait : il a eu droit à son biopic, et de son vivant, qui plus est. Son nom dépasse désormais les cercles d’initiés au nanar, et devient connu du grand public. En France, lors de deux projections de The Room au Grand Rex en sa présence, à l’occasion de la sortie de The Disaster Artist, Tommy a eu droit aux honneurs de la presse, ravi de répondre à des interviews pour Le Monde, Paris Match, Télérama…
 Une salle clairement plus remplie que les premières séances de The Room
Une salle clairement plus remplie que les premières séances de The Room
Il a enfin même pu assister à la cérémonie des Golden Globes 2018, accompagnant James Franco, récompensé par la statuette de meilleur acteur dans une comédie, mais écarté d’un geste du bras pour l’empêcher de s’emparer du micro. Car l’acteur connait bien le personnage et sait qu’il peut s’avérer incontrôlable, surtout en public. Pour autant, Franco reconnait néanmoins une qualité à Tommy Wiseau : sa sincérité quand il a réalisé The Room, cet heureux accident, qu’il ne pourra plus jamais reproduire.
Dans sa préface du Disaster Artist, James Franco revient sur les séances de The Room organisées à travers le monde : “Cet engouement particulier n’est pas uniquement dû au mauvais jeu des acteurs, aux décors nuls ou aux personnages qui jouent au ballon en costard. Ce qui entretient la ferveur du public, c’est le fait que Tommy a mis tout son cœur et toute son âme dans son film."
 Une certaine idée de la réussite
Une certaine idée de la réussite
Mais que reste-t-il aujourd’hui de la sincérité de Tommy Wiseau, acclamé depuis vingt ans pour un mauvais film, alors qu’il avait pour ambition de réaliser un chef-d'œuvre ? En 2017, il a tourné avec son ami Greg Sestero dans le film Best F(r)iends. Le film en deux parties, écrit et produit par Sestero et réalisé par un illustre inconnu, Justin MacGregor, est resté pour le moins confidentiel. À l’exception de ses posts qu’il voudrait viraux sur les réseaux sociaux, et des projets annoncés, mais jamais réalisés (notamment un film de requins dont il avait présenté une supposée bande-annonce tournée avec Greg Sestero), que reste-t-il à Tommy Wiseau aujourd’hui ?
S’il s’affichait volontiers avec James Franco pour accompagner la sortie de The Disaster Artist, Tommy Wiseau ne soutient pas tous les films qui parlent de lui. C’est là que la part d’ombre du personnage resurgit. Jouant la montre de procès en appels, il bloque depuis plusieurs années la sortie d’un documentaire consacré à The Room et à sa vie. Room full of spoons (réalisé par Rick Harpert, un fan de The Room) aurait en effet des révélations à faire sur les origines de Wiseau et de sa fortune. S’il était au départ associé au projet, qu’il a voulu détourner pour apporter une nouvelle pierre à l’édifice de son mythe personnel, Tommy Wiseau menace aujourd’hui Rick Harpert, mais aussi les festivals qui programmeraient le documentaire, leur réclamant plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts. Un sacré businessman, ce Tommy...
La suite est réservée à nos abonnés. Déjà abonné ? Se connecter







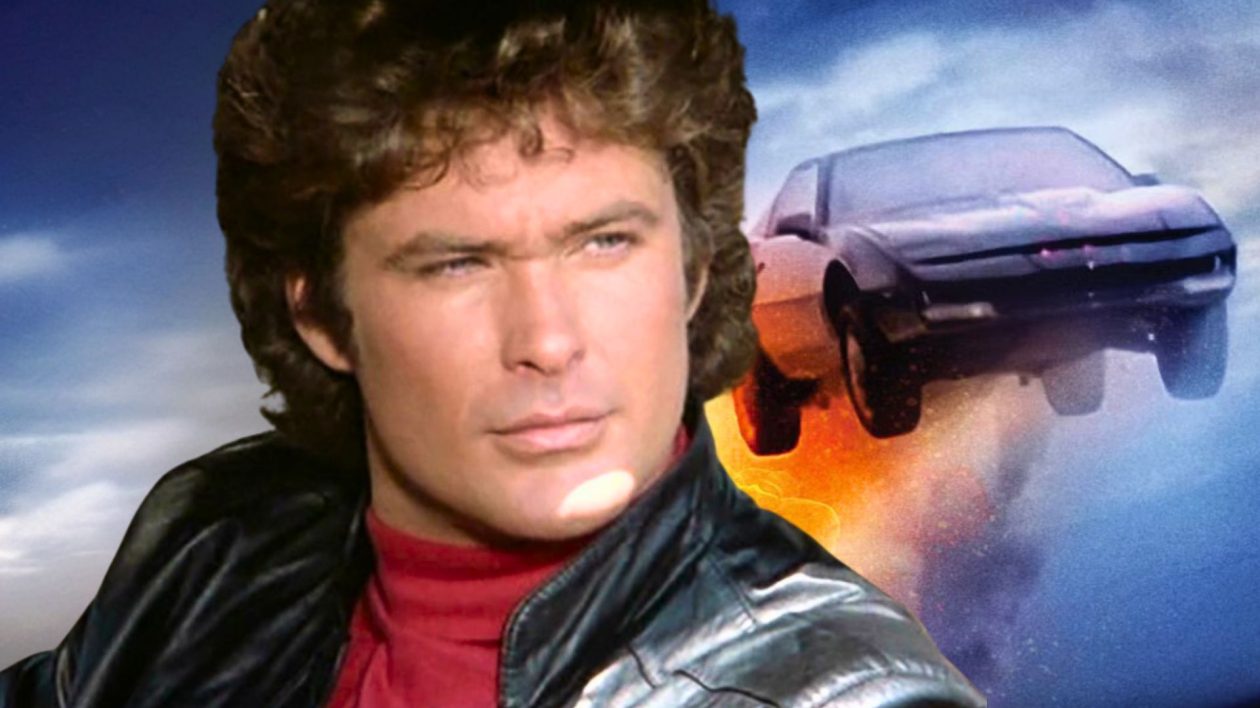

Morte te rire, la meuf ne parle vraiment toujours que des même trucks. Quand c’est pas Lebowski, c’est Wiseau, ou Freddy lol
« » » »Cinéphile » » » »
@albert et @Axlmzo : coquille corrigée, merci !
Du coup c’est 0,1% qu’il garde secret
100 – 99.9 = 0.1, pas 0.01
Je me tape ces temps-ci « Dr Who contre les Daleks » et « Les Daleks envahissent la Terre », deux séries Z qui donnent pas leur place (du grand art).
Préfère « Plan 9 from outer space » le vrai « Citizen Kane » des navets (compte tenu d’l’époque où il a été tourné).
Le film est chroniqué sur Nanarland avec en prime une interview de Tommy Wiseau et Greg Sestero (n’étant pas abonné je ne sais pas si l’article ci-dessus en parle, si c’est le cas désolé). Très drôle. Et on prend la mesure du côté farfelu du personnage.