Un biopic un peu trop bio
Au milieu de toutes les qualités de Slalom, il était impossible de passer à côté de la plus évidente d’entre elles : la mise en scène de Charlène Favier. La réalisatrice imposait déjà un style à la fois proche du réel et très esthétique, nourri par l’angoisse constante de ses thématiques. Dans Oxana, on retrouve cette caméra aussi élégante que nerveuse, et ce vrombissement sourd du pire qui arrive.
Aucun doute : le style Favier continue de faire son chemin et n’a rien perdu de sa superbe. En revanche, c’est un peu tout le reste qui fait du tort à Oxana, et c’est bien dommage. La difficulté vient sans doute de ce qu’il est très difficile d’écrire un personnage comme celui-ci (le scénario est signé Charlène Favier et Antoine Lacomblez), et a fortiori si le personnage en question est pris dans les filets des faits réels et donc toujours limitants.

L’Oxana d’Oxana est une jeune femme qui est tellement habitée par sa révolte qu’elle est incapable de vivre en dehors de son combat. C’est ce qui la rend aussi impressionnante. Mais, malheureusement, le résultat est bien celui-ci : un personnage qui n’existe effectivement pas en dehors de son combat. Un personnage vide, donc, dont tous les moments plus introspectifs, souvent racontés de manière assez taiseuse et suggérée, ne le sont qu’à travers le prisme de l’engagement de la jeune femme.
Sa colère (dont on ne peut être que solidaire, au demeurant) est le seul point de vue, et celui-ci s’essouffle et se lasse à force de n’être pas nourri d’autre chose. Pourtant, la réalisatrice s’attache à dépeindre son héroïne comme une artiste avant tout, et s’arrête de temps en temps sur ses œuvres, ce qui est bienvenu, mais trop peu exploité.

Oxana plus rien à dire
À force de se contenter d’à peine esquisser ce qui meut Oxana (son rapport à la peinture, son rapport à sa famille, ses convictions), sans doute pour éviter la biographie trop lisse ou trop explicative et favoriser la sensation et le sentiment, Favier passe en réalité à côté de son sujet.
Le trop peu est l’ami du rien, et les moments suspendus de silence où la poésie de la mise en scène devrait créer… quelque chose, ne sont en fait que du vide. Et pour les favoriser, la narration survole complètement le raisonnement politique des Femen, leurs relations au sein du groupe, la violence de leurs arrestations, etc. Tout est montré, mais rien n’est vraiment raconté, et pour passer en revue un maximum de faits, le film simplifie tout.

Oxana est réduite à son combat (et à la manière dont elle finit par se sentir déposséder d’elle-même en étant dépossédée de celui-ci), et son combat n’est lui-même n’est jamais abordé, étudié ou questionné en profondeur. Ainsi, aucune véritable fenêtre n’est ouverte ni sur le mouvement Femen ni sur la personne qu’était peut-être Oxana.
La jeune femme finit par devenir, à travers l’interprétation pourtant très impliquée d’Albina Korzh, une représentation presque sexiste : celle d’une héroïne jeune et jolie, mélancolique et boudeuse comme une muse, mais surtout quasi-muette, qu’on utilise comme effigie mais qu’on vide de sa substance. Un comble pour un film dont l’ambition pourtant évidente est de rendre hommage au désir dévorant de liberté, d’émancipation et d’absolu d’une jeune femme qui n’aura accepté de plier devant rien ni personne.
Bref, la narration et l’écriture du film sont comme le résultat d’un tir un peu mal ajusté (et malheureusement fatal) dans une œuvre pourtant sincère qui prouve encore à quel point Charlène Favier est l’une des nouvelles cinéastes françaises à surveiller de près.




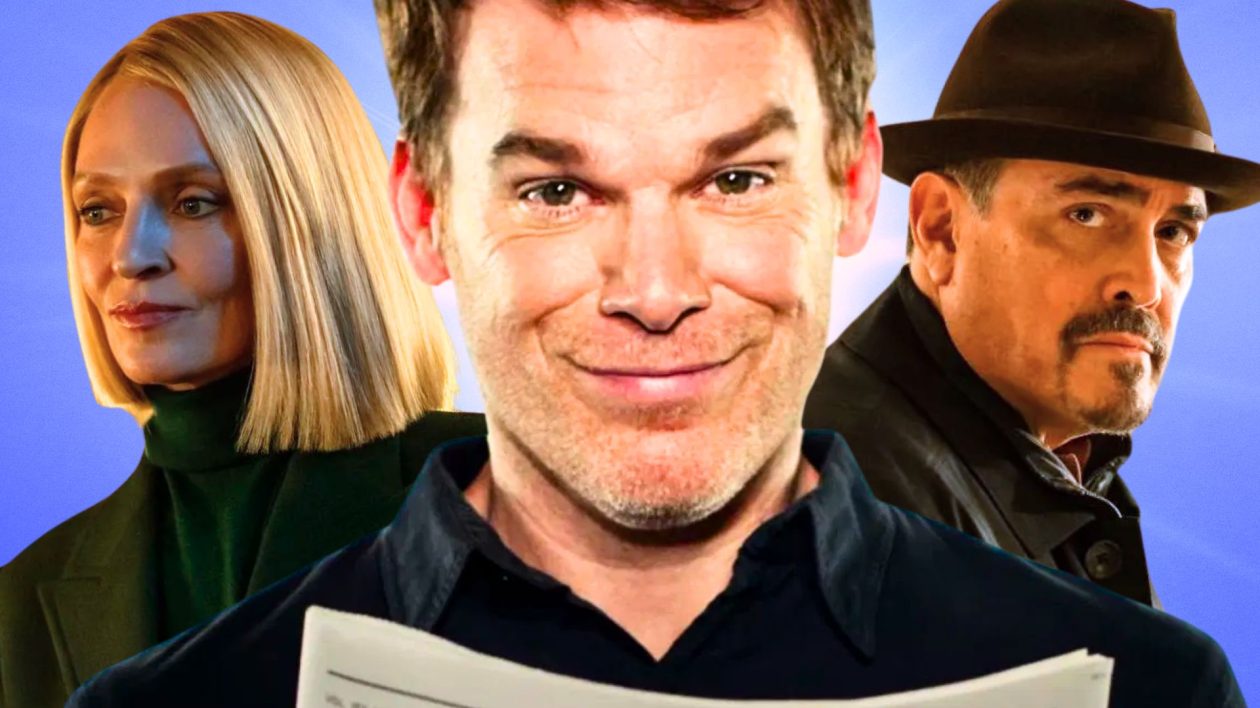
De ce que je comprends, le film s’inscrit à la fois dans le piège du biopic hagiographique et de la Mary Sue. Je trouve que les éléments négatifs qui vous pointez dans votre article seraient en fait l’objet d’un super film interrogeant les figures héroïques qui peuvent être complètement problématiques. Le vide de la personnalité investie uniquement dans un combat collectif ou dans une recherche d’une image idéale dans laquelle s’auto-identifié, un miroir, et une incapacité à se projeter vers l’altérité depuis une identité stable, sans auto-identification, ça me semble être un superbe thème à explorer. La césure entre une capacité à s’exprimer devant des caméras ou un collectif et l’incapacité à s’exprimer dans l’intimité ou la sphère privée s’inscrirait dans ce trouble. On pourrait montrer comment la figure héroïque serait une réduction que s’auto-infligerait un personnage, et ainsi en désacraliser le résultat. Alors… c’est par exemple ce que j’estime voir fait dans X-Men III : l’affrontement final, et j’estime même qu’il est mal aimé exactement pour cette réussite (qui ne se contente pas de montrer le vide de l’héroïsme puisqu’il tourne en ridicule la démonstration de puissance opérationnellement impuissante et vaine).
Il est assez ironique, je trouve, d’avoir un film qui traite d’une part d’Oksana Chatchko – co-fondatrice des Femen donc, et dont une de leurs méthodes pour attirer l’attention sur leur combat est d’apparaitre seins nus – et d’avoir d’autre part une affiche sur laquelle on cache bien pudiquement la poitrine de l’interprète.
On a encore du chemin à faire visiblement…